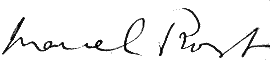A propos de ce blog

Nom du blog :
coquelicot2007
Description du blog :
Invitation au voyage dans l'univers magique et secret de Marcel Proust.
Catégorie :
Blog Littérature
Date de création :
12.12.2007
Dernière mise à jour :
17.12.2013

>> Toutes les rubriques <<
· A la recherche du temps perdu ( extraits ) (33)
· Art, culture et tradition (30)
· Articles sur Marcel Proust (24)
· Balades avec Proust (44)
· Billets personnels (41)
· Cadeaux (210)
· Caftan marocain (58)
· Citation de Proust et tableaux impressionnistes (22)
· Citation du jour (280)
· Citations de Proust (50)
· Divers (174)
· L'art (1)
· Oeuvres d'art (3)
· Paysage de mon pays (304)
· Peintres impressionnistes (4)
· Peinture marocaine (51)
· Propos sur l'art (12)
· Propos sur la musique (9)
· Propos sur Proust (30)
· Tableaux impressionnistes (153)
· Video (15)
Accueil
Gérer mon blog
Créer un blog
Livre d'or coquelicot2007
Contactez-moi !
Faites passer mon Blog !
· Caftan marocain
· Tableau impressionniste : Monet
· La phrase la plus longue de Proust : 243 mots
· paroles de la chanson de Dave " Du coté de chez Swann"
· Citation de Proust et caftan marocain
· Impression soleil levant
· Citations sur la tolérance
· Tableau impressionniste : Degas
· les différentes fonctions de l'art
· Caftan marocain
· Quelques citations de Proust sur l'amour et la jalousie
· Tableau de William Turner
· Claude Monet, "Le Parc Monceau"
· Du côté de chez Swann - Résumé
· Caftan marocain
il est magnifique, fraicheur ,candeur une pointe de mystère elle est d une beauté naïve et pure.vraiment j aim
Par diana, le 24.12.2013
cher auteur de du côté de chez proust.
je suis heureux de vous signaler le lancement de mon blog lefoudeprous
Par Patrice LOUIS, le 23.12.2013
cool
Par lola, le 27.11.2013
genial cette phrase !!! cè du jamais vu :-) ????o.ohttp:// ***@***.ca.cen terblog.net
Par berry, le 13.11.2013
très beau tableau, c'est stupéfiant
Par LAMQADDEM, le 16.08.2013

- · قفطان صولي
- · akhir modil kaftan
- · caftan akhir tiraze
- · je ne suis jamais seul quand je suis avec marcel
- · blog marcel proust
- · rose mr. proust
- · coquelicot 2007
- · van gogh
- · proust coquelicot
- · caftan maroc
Citation de Marcel Proust
« Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur ; elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries. »
MARCEL PROUST
Julia Kristeva, Le temps, la femme, la jalousi selon Albertine
Julia Kristeva
LE TEMPS, LA FEMME, LA JALOUSIE, SELON ALBERTINE
Je n’aborderai pas le débat « génétique » que soulève Albertine disparue : des spécialistes l’ont déjà largement commenté ici, vous en connaissez les arcanes. J’essaierai de reprendre quelques aspects, qui me paraissent fondamentaux, de ce que j’appelle l’expérience de Proust, telle qu’elle apparaît sous la forme d’une écriture romanesque. J’interrogerai ces aspects fondamentaux à travers le personnage d’Albertine, qui se cristallise tout au long du roman, avant de s’affiner dans la dernière version d’Albertine disparue. Je m’arrêterai donc brièvement à trois thèmes que j’ai développés dans Le Temps sensible, mais que j’aborderai aujourd’hui dans une autre perspective.
Tout d’abord, quel féminin Proust dévoile-t-il à travers Albertine ? Je suggérerai que l’homosexualité féminine ou, plus spécifiquement, l’identification du narrateur à celle-ci, devient le centre de la sublimation proustienne ; ceci me conduit, plus largement, à soutenir plus largement que la position féminine du narrateur est « le point de fuite » de l’imaginaire masculin, littéraire et artistique. Chez Proust, cette sexualisation est une étape décisive vers une désexualisation paradoxale, qu’il semble considérer, dans Albertine disparue comme l’aboutissement de l’acte imaginaire. Il s’agira en somme de sexualiser, en se mettant dans la position féminine de l’acte sexuel, afin de pouvoir désexualiser. Serait-ce la logique préconsciente de l’acte imaginaire que l’auteur de la Recherche appelle, dans une lettre à Lucien Daudet de 1913, une « transsubstantiation » ?
Le deuxième thème, auquel nous conduira cette réflexion, concerne la jalousie, centrale dans la traversée proustienne de l’expérience amoureuse. J’essaierai de démontrer que la jalousie est un échec de l’imaginaire, comme le montre le personnage de Swann. En revanche, la mise en récit de la jalousie est le recours ultime contre le mal d’amour.
Enfin, je soutiendrai que la sublimation ainsi comprise et agie, comme une diversion du désir, modifie le rapport du sujet au temps : en inscrivant les sensations dans les signes du langage, la sublimation n’évite pas la foi religieuse ; elle n’est pas non plus une défense contre celle-ci, mais constitue sa résorption même dans l’expérience romanesque, au sens d’Erlebnis, qui, dès lors, rivalise en vérité avec les cathédrales.
I. Albert, Albertine et le narrateur
Les amateurs de « clés » ont vite découvert, derrière « la fameuse Albertine » l’ami et chauffeur de Proust, Alfred Agostinelli, qui devint pilote et s’écrasa en monoplan pendant un vol d’entraînement le 13 mai 1914. Dans la mesure où l’auteur s’avoue « comme Barbe-bleu », « un homme qui aimait les jeunes filles », on peut également deviner, sous les traits de la mystérieuse prisonnière, les souvenirs qu’ont dû laisser Marie de Benardaky, Marie Nordlinger, plus certainement encore Marie Finaly ; sans oublier Laure Hayman et Louisa de Mornand, auxquelles Proust adressa des lettres chaleureuses. La dernière prétendit même avoir eu, avec le narrateur, une « amitié amoureuse » et promit de révéler des lettres plus « intimes » encore que celles qu’elle publia en 1928 : les amateurs les attendent encore. D’autres évoquent la « mystérieuse jeune fille » dont « le nom ne nous est même pas connu, bien qu’elle puisse être encore en vie aujourd’hui ».
Le détective le plus scrupuleux est forcé de reconnaître la dominante mâle dans les « clés » d’Albertine, sans négliger l’intimité proustienne avec la sensibilité des femmes. La théorie que le narrateur développe dans La Prisonnière sur une homosexualité non pas de « coutume » mais diffuse, « involontaire » (comme la mémoire ?), « nerveuse », « celle qu’on cache aux autres et qu’on travestit à soi-même », laisse penser que le narrateur est un adepte du transsexualisme : appartenance de chaque individu à (au moins) deux sexes, et passage implicite, sous-jacent, « involontaire » de chacun de nous à travers la cloison, officiellement infranchissable, de la différence sexuelle. Il n’en reste pas moins que c’est en connaisseur de femmes que se présente le narrateur de la Recherche et que, si transsexualisme il y a, il n’opère pas de la même manière chez Albertine et chez Charlus.
I. 1. « Unes femmes »
Qu’est-ce qu’une femme pour le narrateur, quand cette femme est Albertine? Sous quel rôle se cache-t-il lorsqu’il choisit de se présenter comme l’amant d’Albertine ? Quelle différence, enfin, entre Gomorrhe et Sodome ?
Tout d’abord, la femme ici n’a pas d’identité ; par principe, une femme ne serait pas individuée. Pétale dans un bouquet de fleurs, mouette dans une bande de volatiles, ou simple reflet, détail, trait indistinct et interchangeable. Unes femmes est toujours au pluriel indifférencié : elle va par groupe ou essaim, dans la promiscuité. « Un tableau charmant, ces mélanges ne sont pas très stables », « Mélanges » plutôt impressionnistes d’ailleurs, dont Elstir, à qui le narrateur rend visite, croyant se mettre un instant à l’abri de l’envoûtement des jeunes filles, saisit parfaitement la magie.
L’instabilité d’Albertine se trahit plaisamment, avec une drôlerie peut-être inconsciente de la part du narrateur, par l’incessante migration de son grain de beauté : de la lèvre au menton au-dessous de l’œil. Dans un tel brouillard de détails et de confusion, on comprend que le narrateur ne puisse « connaître » son Albertine que « par soustraction ». Plus auto-érotique qu’érotique, cette séduction polymorphe de l’adolescence trouve son image réussie dans le jeu d’Albertine avec le diabolo : elle le manœuvre comme « une religieuse son chapelet », en faisant penser au golf « qui donne l’habitude des plaisirs solitaires ». Masturbation réussie, « grâce à ce jeu elle pouvait rester des heures seule sans s’ennuyer ».
Cependant, le narrateur a tôt fait de flairer, sous l’absence d’identité, la menace d’un conflit : sous les « bonnes façons » d’Albertine perce déjà « son ton rude et ses manières “petite bande ” ». Mais ce sont des détails fétiches, sa voix, ses mains, qui animent les contours indécis et procurent au narrateur ce qu’il prend pour l’amour.
Lorsque cette identité-figure-visage ne fuit pas, comme c’est le cas à l’hôtel de Balbec où le jeune homme essaie en vain d’embrasser des « raisins de jade », « décoration incomestible », mais qu’elle s’offre - réelle ou facile -, le baiser devient tourbillon. A cette différence près, comparée aux débuts innocents, que désormais le flux est destructeur. Le faste pictural à la manière d’Elstir se révèle brusquement être un assemblage de « détestables signes », prémonition de la « bombe » qui éclatera plus tard.
Arrêtons-nous un instant sur ce baiser impossible. Le narrateur soutient que l’homme n’a pas d’organe pour toucher cet « abîme inaccessible », cette absence d’« identité » si vertigineuse qu’aucun « calcul de probabilité » ne saurait nous assurer de la « revoir » – « […] l’homme […] manque cependant encore d’un certain nombre d’organes essentiels, et notamment n’en possède aucun qui serve au baiser. A cet organe absent il supplée par les lèvres, et par là arrive-t-il peut-être à un résultat un peu plus satisfaisant que s’il était réduit à caresser la bien-aimée avec une défense de corne ». On peut méditer ou rire longuement sur cette métonymie de la « corne », dure mais inutile, et de la « lèvre », sensible mais impuissante ; elle traduit, quelle que soit l’inventivité de l’amoureux, l’ « absence d’organe » de l’homme pour dominer le tourbillon de la non-identité féminine. Cette colère prend souvent l’aspect d’une aversion, pur dégoût qui succède au désir : « Des races, des atavismes, des vices reposaient sur son visage [...] ». Ou, encore plus brutalement : « fondue, maigre, enlaidie par un chapeau qui ne laissait dépassait qu’un petit bout de vilain nez et ne voir de côté que des joues blanches comme des vers blancs ».
Pourquoi l’opulence initiale des fleurs et des mouettes confondues se transforme-t-elle en cette catastrophe d’identité ? La facilité, le désir permis qui s’annule dans son accomplissement même ne suffisent pas à tout expliquer. Aimer Albertine, c’est l’aimer « dans toute sa hideur ». Que cette « hideur » qui « nous force d’aimer ce qui nous fera souffrir » soit un mélange de jouissance impossible, parce que donnée de femme à femme, ne cache pas le fait que cette homosexualité féminine renvoie le narrateur à la culpabilité incontournable du désir, quel qu’il soit, et plus particulièrement à la culpabilité incontournable du désir homosexuel. Car ce désir est contre la loi et, fondamentalement, contre la première des lois qui régit la communauté des vivants, celle de la procréation.
I. 2. Objet et/ou identification
Ayant atteint ce point où l’amour dévoile son impossibilité intrinsèque, le narrateur va s’identifier à la culpabilité du désir féminin homosexuel. Je voudrais attirer votre attention sur le chemin de cette identification, qui n’apparaît pas immédiatement puisque Albertine n’est pas Marcel, mais seulement et pour un temps, l’objet de son désir. Je soutiendrai cependant qu’Albertine est bel et bien le narrateur. Cette identification nécessite pour commencer la distinction opérée par Proust entre l’homosexualité de Gomorrhe et celle de Sodome. Sodome est fou, et Gomorrhe peut l’être aussi, mais seulement quand il l’imite (Léa, Mlle Vinteuil et son amie, Albertine lorsqu’elle partage l’excitation de jeunes saphistes ou de Morel). Pourtant, Gomorrhe est différent, car Gomorrhe a la particularité de déprimer. Mlle Vinteuil, déjà, dissimulait – sous ses apparences d’« artiste du mal » et de « sadique » – un « air las, gauche, affairé, honnête et triste ».
Le désir gomorrhéen serait, dans cette vision qui semble être celle de Proust, une trahison de la mère. La mère du narrateur le ressent sourdement puisqu’elle ne trouve que des propos négatifs pour qualifier la maîtresse de son fils : « […] je ne sais la louer que par des négatives ». Qu’il soit hétérosexuel, sodomite ou gomorrhéen, le désir serait-il toujours une Orestie, une mise à mort de Clytemnestre ? Les raccourcis du narrateur le laissent entendre en cet endroit de la Recherche, alors que le sentiment de culpabilité et de faute s’installe de manière indélébile dans les représentations proustienne de l’érotisme.
Avec sa particularité de se déprimer, Gomorrhe approche la fabuleuse aptitude à la tristesse que distille le narrateur lui-même. Proust projette sur Albertine le fantasme d’une homosexualité passive, plus dépressive que criminelle, qui sera un passage obligé dans le processus de sublimation. En d’autres termes, la culpabilité s’inverse en mélancolie : je ne suis pas un fou criminel, mon désir est follement coupable. Dès lors, le passage à l’acte érotique peut être relayé, sinon remplacé, par le passage à l’acte de l’écriture : par la sublimation.
Ainsi, il ne suffit pas de dire qu’Albertine masque Albert, qui serait Agostinelli. Elle fait beaucoup plus. Elle trahit la part gomorrhéenne de l’homosexualité du narrateur lui-même : complice d’Albertine, connaisseur exquis de ses jouissances et de ses trahisons, le narrateur s’offre par l’intermédiaire d’Albertine le plaisir subtil de se dépeindre en femme, d’explorer la part passive de son homosexualité.
J’espère vous surprendre en vous disant qu’un écho de cette identification à Albertine, par le biais de la dépressivité, se trouve dans Les Bienveillantes de Jonathan Littell. Maxime, le narrateur de ce roman, a des plaisirs homosexuels « passifs ». Question : les lecteurs modernes qui n’hésitent pas à s’identifier avec ce tortionnaire, quand ils ne vont pas jusqu’à « comprendre » que le « mal est en nous » (croient-ils), voire à le « banaliser » – encore une fausse lecture de Hannah Arendt ! –, l’auraient-ils fait si Maxime était « actif », « sadique », agressif plutôt que passif, « féminin » et réceptif ? Le récit proustien diffère de celui de Littell, non seulement par la pudeur d’un autre siècle avec laquelle Proust aborde la perversion, mais surtout par l’onde porteuse du remords qui traverse la Recherche. Le narrateur du temps perdu met en scène une homosexualité blasphématoire et coupable, « la seule vraie », « houleuse », « nerveuse », qui démasque dans le désir un désir à mort. L’homosexualité féminine serait-elle plus blasphématoire encore, dans son désir à mort, parce que, non contente de blesser la mère en désobéissant aux lois de la procréation, elle abolit la maternité elle-même ? Œdipe se dévoile en vérité sous les traits d’Oreste : le désir à mort est un désir matricide. Cette découverte amorce un nouveau départ de l’intrigue romanesque : comment interrompre ce désir gomorrhéen (et/ou homosexuel passif) aussi jubilatoire que coupable ?
D’abord en l’enfermant, afin de supprimer les occasions de jalousie. En provoquant le départ, ensuite, et notamment le voyage à Venise. La solution du narrateur est toute prête, lorsqu’Albertine elle-même prend l’initiative : « Mademoiselle Albertine est partie ». De quoi raviver, cependant, le désir du possesseur imaginaire : « Et ce n’est pas seulement elle qui était devenue un être d’imagination c’est-à-dire désirable, mais la vie avec elle qui était devenue une vie imaginaire, c’est-à-dire affranchie de toutes difficultés de sorte que je me disais : ‘Comme nous allons être heureux !’». Enfin, en supprimant l’objet de désir par le deuil, en le faisant mourir. Un télégramme annonce la mort de la moderne Béatrice. Un simple télégramme de quelques lignes suffit car, en dépit de ses dénégations, Albertine avait depuis longtemps entrepris de disparaître. Désormais, Albertine est abandonnée, elle a abandonné, elle s’est absentée du désir du narrateur, ce qui revient à mourir.
Le travail du deuil avait commencé depuis la séquestration de l’insaisissable féminitude. La mise en scène du mariage était-elle déjà une mise au caveau de l’amour ? Mais le deuil est fertile, car il déclenche « la […] renaissance des moments anciens », et démultiplie la personnalité du narrateur : « Ce n’était pas Albertine seule qui n’était qu’une succession de moments. C’était aussi moi-même […]. Je n’étais pas un seul homme »
Nous pouvons transposer sur le narrateur cette multiplicité que nous connaissons déjà à propos d’Albertine. Désormais — mais le processus ne cesse de se mettre en place tout au long de l’œuvre — l’amoureux est devenu écrivain. La mémoire involontaire tant évoquée est ici prise sur le vif, et les événements funèbres remémorés et/ou racontés permettent enfin de dépasser le destin d’un Swann : plus de « célibataire de l’art », il s’agira « d’atteindre l’indifférence initiale », mais en traversant « en sens inverse tous les sentiments », jusqu’au temps perdu de la bisexualité psychique. Hallucination, passé et présent télescopés vont se nourrir de cette mort de l’objet pour se muer doucement, nécessairement, en souvenir, trace, impression, écriture de ma propre bisexualité, de mes affects infantiles. De cette manière, je retrouverai le temps — absolument pas perdu — de l’infantile. Ce sera la patience de l’écriture.
La disparition d’Albertine, au sens banal et au sens fatal du terme, provoque la providentielle résurrection de ce temps incorporé qu’est l’écriture. La mort de ce qu’on a cru ou voulu « posséder » sera la condition pour que « tant de nos souvenirs, de nos humeurs, de nos idées partent faire des voyages loin de nous-mêmes ». Il ne s’agira pas seulement de retrouver l’enfance, mais aussi de la basculer dans l’Etre. L’incommensurable ambition de la Recherche tend à désubjectiver l’expérience, à passer du subjectif à l’ontologique. Poursuivie tout au long de l’œuvre, avec des acmés repérables dans les fragments philosophiques et les méditations esthétiques, cette désubjectivation atteint dans la « version courte » d’Albertine disparue, sa cristallisation narrative : j’y reviendrai. Retenons pour l’instant que le narrateur enterre avec Albertine l’illusion d’aimer, qu’il affirme la solitude du créateur. Orphée a dévoré sa Bacchante en se parant lui-même de sa « robe ». N’est-ce pas ainsi qu’il appelle son œuvre, quand il ne la baptise pas, en toute simplicité, une « cathédrale»?
Mais attardons-nous encore à ce voyage intersubjectif entre les deux sexes. Ne subsiste d’Albertine qu’un objet d’art — sculpture, paysage ou musique, on ne sait —, insaisissable quoi qu’il en soit, et à rechercher sans relâche entre avenir et passé. « C’est le malheur des êtres de n’être pour nous que des planches de collection fort usables dans notre pensée ». La page sera l’écran sur lequel Je vais projeter mon appropriation de Sa dépression et de Votre bisexualité.
Albertine suicidée révèle enfin la tyrannie du remords chez la lesbienne, mais aussi la fragilité de cette « folie criminelle » dont elle croit être atteinte, et dont la volupté ne résiste pas à l’appel mortifère du sein : « […] elles sont certainement au comble de la jouissance. On ne sait pas assez que c’est surtout par les seins que les femmes l’éprouvent. Et voyez, les leurs se touchent complètement ».
Annoncée dès Sodome et Gomorrhe, la gomorrhéenne serait donc jusqu’au bout plus létale que cruelle. Proust apprivoise la violence du désir, dont il n’ignore pourtant pas les latences criminelles ; telle la folie flagellée de Charlus. Mais il préfère se replier sur la position féminine de l’homosexualité mâle. C’est dire que quelque connaisseur qu’il soit de la sexualité féminine, Proust compose à proprement parler l’homosexualité féminine dans la Recherche en y mêlant sa connaissance de l’homosexualité mâle. On comprend mieux ainsi la gêne de Colette qui, grande admiratrice de Sodome et Gomorrhe (et de Proust en général, à la fin de sa vie, malgré des allusions antisémites, du temps de sa jeunesse, quand elle n’était encore que Mme Willy), écrit Le Pur et l’Impur pour opposer à la gomorrhéenne proustienne une homosexualité féminine primaire, endogène et innocente, dans les noces de la fille avec la mère.
Tout au contraire, en prenant Albertine comme alter ego, Proust choisit l’aspect létal du désir contre sa criminalité. Il prend ses distances avec une part essentielle de sa personnalité, il tend à se séparer de sa propre mélancolie, et ouvre ainsi la voie vers les « succédanés des chagrins » et des repentances : vers l’art. Ni mélancolique, ni flagellant/flagellé, mais jouant tous les rôles à la fois, le narrateur compose avec Albertine son autoportrait cubiste.
II. Jalouser ou écrire
Chaque fois que je l’ai rencontrée, personnellement ou chez mes patients, la jalousie m’est apparue comme un détournement de la haine. L’amoureux (s’) idéalise son aimé (e), mais c’est son propre moi, fondé sur les frontières problématiques du narcissisme, qu’il (elle) porte au zénith dans l’épreuve de la passion.
La vie amoureuse de Swann met en scène ce qu’on pourrait résumer sous la forme du « soliloque du jaloux » : « Elle n’est pas ce que je veux posséder, elle n’est pas moi, donc je devrais la rejeter – ce que veut dire la haïr. Or, il n’y a que moi. Et je ne peux me haïr moi-même, cela me conduirait à la dépression ou la maladie. Ils viendront, bien sûr, ils sont déjà là, les faiblesses et les symptômes, mais laissons faire le temps. Entre-temps, dans l’intervalle perdu, la jalousie aide à différer la mort : je me hais un peu moins en suspectant les haïssables coups de l’autre. »
Incursion de la haine dans le désir, la jalousie véhicule l’agression sous une forme inversée : un amour tendu vers un autre imaginaire qui la détourne de soi. Plutôt que de se haïr, l’amoureux jalouse un « autre aimé ». Son pseudo-objet n’apparaît jamais dans ce qu’il a de spécifique, de différent – forcément inférieur au désir idéalisant et nécessairement traître. Serait-ce le cas, la lucidité intermittente du passionné ne pourrait que le conduire à la ruine de l’autoconstruction qui est son amour. Mais le jaloux n’est ni déprimé ni malade : il n’a pas le temps de se replier sur soi, sur un temps à soi. Dans le feu de son obsession jalouse, il déchiffre péniblement le temps de son bourreau et jouit douloureusement des signes de sa nullité ou de ses traîtrises. Aussi, son agressivité vis-à-vis de la symbiose amant/aimé, dont il ne peut se détacher, se métamorphose-t-elle en un excès d’interprétation : le jaloux se consacre à disséquer le sens de la haine et/ou de la blessure, plutôt que d’admettre l’indépendance de l’aimée ou l’incommunicabilité des amants.
Le narrateur, quant à lui, va travailler au contraire à partir de cet alliage entre la douleur et la pensée. Ainsi posée a priori comme œuvre de la pensée, sa jalousie pourra s’achever en œuvre de fiction. Le roman sera cette poursuite de la jalousie par d’autres moyens. Comment s’opère donc l’alchimie qui transmue la jalousie en écriture ?
Le narrateur le sait d’emblée, sa jalousie relève de la pathologie : une « phobie qui me hantait », un « mal incertain ».Et, comme instruit par l’expérience de Swann, il écrit qu’il porte en lui-même cette maladie, que l’objet aimé y est pour peu de chose, que seule l’imagination attise le mal. « Ma jalousie naissait par des images pour une souffrance, non d’après une probabilité […]. On a beau vivre sous l’équivalent d’une cloche pneumatique, les associations des idées, les souvenirs continuent à jouer. » Centrée sur la susceptibilité douloureuse du jaloux, la jalousie n’est, pour le narrateur, qu’une fantaisie bornée : « Lutte inutile, épuisante, enserrée de toutes parts par les limites de l’imagination ». Est narrateur celui qui saura dépasser « les limites de l’imagination » pour transformer son état « lamentable » en édifice imaginaire.
Entendons : contrairement à Swann, l’écrivain peut imaginer une histoire, des histoires, dont il sait être le centre émetteur. Il combat ainsi le tourment de l’inconnu et remplace les douleurs du cœur par les intermittences d’une intrigue qui n’est due qu’à sa propre imagination. « Maintenant, la connaissance que j’avais d’eux [les gens, les lieux] était interne, immédiate, spasmodique, douloureuse […]. Mais ce qui me torturait à imaginer chez Albertine, c’était mon propre désir perpétuel de plaire à de nouvelles femmes, d’ébaucher de nouveaux romans […]. Comme il n’est de connaissance, on peut presque dire qu’il n’est de jalousie que de soi-même. L’observation compte peu. Ce n’est que du plaisir ressenti par soi-même qu’on peut tirer savoir et douleur. »
Ce triomphe romanesque se paye d’un renoncement. Le narrateur fait mourir sa maîtresse physiquement, par un bref et banal télégramme annonçant une mort déjà sentimentalement et philosophiquement consommée.
On comprend, dans ce contexte, la colère de Proust contre Emmanuel Berl lui annonçant son mariage : pour celui qui s’est engagé dans la fiction comme dans un absolu, l’amour avec son cortège de jalousies ou de mariages ne peut être que naïvetés, badinage insipide. L’amour ignore la fiction.
III. Comment le temps de la foi devient le temps de la contraction ontologique.
III. 1. Du désir à l’extratemporalité
Je ne reprendrais pas aujourd’hui une lecture du temps proustien à la lumière du débat implicite que le narrateur mène avec Bergson, ni au regard du « temps du souci » ou de l’ « espacement » chez Heidegger. J’insisterai simplement sur le fait que la traversée du désir, telle que nous venons de la décrire avec Albertine disparue, conduit Proust à une extratemporalité : l’espace de Venise se prête alors à merveille, pour scander voire interrompre les péripéties et la chronologie du désir, et le télescopage du réel dans la dernière version d’Albertine disparue confirme, si besoin en est, cette « sortie » du psychologique dans ce qu’il faut bien appeler la contraction ontologique.
On connaît le cloisonnement du temps (comme d’Albertine ?) chez Proust : « Une heure n’est pas une heure, c’est un vase rempli de parfums, de projets et de climats… » ; « le geste, l’acte le plus simple, reste enfermé comme dans mille vases clos dont chacun serait rempli de choses d’une couleur, d’une odeur, d’une température, absolument différentes ». S’y ajoute une extra-temporalité qui évoque Bergson, mais aussi le zeitlos (le hors-temps) de l’inconscient selon Freud : « […] l’autre vie, celle où on dort, n’est pas […] soumise à la catégorie du temps ; « […] jouir de l’essence des choses, c’est-à-dire [vivre] en dehors du temps ».
Pourtant, ce « pur temps » lui-même est toujours tributaire, chez Proust, du temps linéaire numérique. La pluralité proustienne extériorise le temps commun (« plusieurs plans à la fois […] des poupées extériorisant le Temps »), et, loin de s’y dérober, en révèle l’universalité : « Je n’étais pas situé en dehors du Temps, mais soumis à ses lois ». Personne mieux que le narrateur de la Recherche n’a révélé cette ambiguïté essentielle à la littérature, où l’imaginaire comme le phénoménal traduisent le symbolique ou l’ontologique. Toutefois, le « pur temps » proustien – qui saisit le passé et le présent par l’intermédiaire de la coïncidence métaphorique – impose la coprésence du passé au présent. La boucle métamorphique du temps proustien (sensations immanentes au télescopage entre présent et passé) évoque la simultanéité du souvenir et de la perception : la coïncidence d’un présent contracté avec le passé, voire un présent atteint à la seule condition de rejoindre le niveau le plus contracté du passé.
Une différence irréductible cependant éclate entre la « mémoire involontaire » de Proust et la « pure durée » bergsonienne.Dans son expérience discursive, occupée à capter les dispositions spatiales des caractères, la mémoire involontaire de Proust est une contraction intensive et a priori ontologique. La distinction entre transitivité subjective et contraction ontologique n’a, en définitive, pas de sens dans l’expérience imaginaire proustienne. En effet, dans le temps de deux images ou, mieux, de deux impressions, la sensation proustienne est toujours déjà constituée à l’interface entre l’Etre et la psyché. Elle ne se contente pas de contracter, sur la surface réceptive de la subjectivité, des vibrations et des tourbillons extérieurs. Elle participe des deux, elle manifeste la coprésence du narrateur à l’Etre, leur inopérante dichotomie. Les dualismes, finalement dépassés par Bergson dans son « dualisme génétique », restent toutefois sous-jacents à sa pensée d’inspiration psychique et subjectiviste. En revanche, l’expérience imaginaire de Proust s’immerge aussitôt dans l’ontologique, pour mieux le désessentialiser.
Il n’existe pas de transitivité subjective chez Proust, pour laquelle chaque réminiscence, filée dans une image s’enchaînant à une autre, serait distincte de la contraction ontologique. Fidèle à la volonté de l’Etre chez Schopenhauer, la dynamique temporelle proustienne est celle de l’Etre lui-même, par le même mouvement sensoriel et langagier qui fait d’elle une mémoire involontaire du narrateur. La mémoire involontaire, simultanément perception et signification, serait donc l’équivalent de la musique chez Schopenhauer. Natura naturans, musique de l’Etre, la mémoire involontaire exprime l’architectonique de l’Etre coïncidant avec l’artiste. Le finale théorique du Temps retrouvé ontologise le temps vécu du narrateur. Cependant, dès le début du roman, dans le triplet de la sensation-image (impression, hiéroglyphe, chiffre) -idée, la mémoire involontaire était toujours déjà ontologique. Le style est « vision transsubstantielle », et le temps – immédiatement « incorporé ». L’alchimie de cette jonction duelle était toujours déjà là, dans la dynamique de l’expérience imaginaire et dans le statut particulier de l’impression qui résorbe le signe.
III. 2. Venise : la « pierre angulaire »
La sublimation proustienne, dont nous avons suivi la logique à travers Albertine et sa disparition, culmine ainsi dans une écriture de l’expérience imaginaire qui s’arrache à la chronologie du désir (vie – conflit amoureux – mort) pour s’installer dans la certitude de dire vrai. Le psychique s’exile alors dans la construction de l’œuvre contractée jusqu’à son sens ultime : la transsubstantiation. Dans la coïncidence du sensible avec le dire vrai, dans le choix du « détail » le plus polyphonique, le plus kaléidoscopique : raccourci maximal d’un maximum d’« intrigues ».
Albertine disparue, et sa dernière version en particulier, ne sont pas le contraire de la prolifération phrastique en « paperoles », chère aux proustiens. Ici les proliférations se sont resserrées en lieux, mots, noms propres : tous surchargés du temps passé de l’œuvre elle-même, des ambivalences érotiques du héros, des héros. Et de l’histoire judéochrétienne en prime. A vous, à nous, de les déplier dans notre mémoire, qui sera une lecture, à la manière de Proust : ouverte vers l’œuvre et vers l’Etre.
Ainsi, le Séjour à Venise, consécutif à la mort consommée d’Albertine, s’ouvre sur l’ange d’or du campanile de Saint-Marc, « rutilant d’un soleil qui le rendait presque impossible à fixer », « les bras grands ouverts », une « promesse de joie plus certaine que celle qu’il put être jadis chargé d’annoncer aux hommes de bonne volonté ». Le symbole christique est évident, et Venise – comme l’art du narrateur – aspire à le dépasser par une promesse « plus certaine » encore. Quelques thèmes, finement tissés dans ce chapitre relativement court, affirment encore l’idée proustienne de l’art comme transsubstantiation.
- Combray et Venise, une fois de plus imbriqués, relient enfance et âge adulte, France et Italie, deux sensations différentes condensées en métaphore. La mort est présente par l’évocation du décès de la grand-mère ; elle fait écho à la disparition plus récente d’Albertine, qu’il s’agit enfin d’incorporer et de métamorphoser dans le tréfonds de l’écriture : « […] je sentais qu’Albertine d’autrefois, invisible à moi-même, était pourtant enfermée au fond de moi comme aux “plombs” d’une Venise intérieure, dont parfois un incident faisait glisser le couvercle durci jusqu’à me donner une ouverture sur ce passé ».
- La ville de Venise elle-même figure à la fois un fond, l’appel d’un secret et l’extériorité la plus civilisée, la nature saisie par l’imagination humaine, domestiquée, mais sans banalité, superbe dans le quotidien comme dans le luxe.
- Le Christ proustien est « un Christ équivoque et un peu terne » dans ce « tableau vivant étendu et diapré », soutenu de « belles colonnes orientales », et côtoyant « une force du passé ». « Nous nous y attardions longtemps, en quittant le baptistère ».
- Le mystère de cette Venise incarnée réside cependant dans la présence maternelle : « […] maman me lisait les descriptions éblouissantes que Ruskin en [de Venise] donna, la comparant tour à tour aux rochers de corail de la mer des Indes et à une opale ». Ce passage évoque les souvenirs de longues années de traduction commune et amorce une véritable osmose mère-ville qu’impose la version définitive du texte. Une étrange fusion s’opère en effet entre le corps de la mère et le corps de Venise.
Par la magie de cette infiltration, la fenêtre vénitienne devient à son tour la matière qui soutient l’amour maternel – la fenêtre est l’amour pour la mère. Il en est de même du baptistère où prient les femmes ferventes qu’on dirait sorties d’un tableau de Carpaccio : « elle [la mère] y a sa place réservée et immuable comme une mosaïque ». Discret mariage du judaïsme et du christianisme.
Pourtant, la mère décide-t-elle de partir, et le héros, apprenant l’arrivée de Mme Putbus, décide-t-il de rester par un brusque sursaut d’indépendance, « la ville que j’avais devant moi avait cessait d’être Venise ». Mensongère, factice, simple amas de pierres qu’avilit davantage encore ce Sole mio, médiocre chant de désespoir : en contrepoint à l’ange d’or de la promesse du début du chapitre, « la voix de bronze du chanteur, un alliage équivoque, immutable et poignant ». Heureusement, il est temps de rejoindre la gare, de reprendre le train, de revenir à maman.
Il n’en reste pas moins que la pureté de cette Venise incestueuse est la seule que Proust retienne pour la version « au net » de 1916. Le blasphème s’y faufile toujours, mais réduit, comparé aux versions initiales. L’auteur introduit le marquis de Norpois et la croulante Mme de Villeparisis, horriblement enlaidie, qui offrent le spectacle d’une humanité débile dans ses préoccupations politiques et matrimoniales. Une dépêche annonce qu’Albertine serait vivante. Une lettre de Gilberte apprend au narrateur son mariage avec Saint-Loup, mais cette lettre introduit le thème du faux : la « dépêche » était d’elle, son écriture tarabiscotée a induit la méprise. Venise incarnée, Venise maternelle, est aussi une Venise dérisoire et fausse. Perdure, néanmoins, l’éblouissement.
Les brouillons non retenus sont cependant autrement plus équivoques. A la piste idyllique du soubassement de l’incarnation que serait l’amour entre le fils et la mère, les avant-textes ajoutent une variante scandaleuse. Le brouillon le plus saugrenu, et qui ouvre des abîmes érotiques sous le thème de l’incarnation vénitienne, concerne l’épisode de la femme de chambre de la baronne Picpus ou Putbus.
Finalement, pressé par la maladie, mais surtout guidé par la double exigence de composition et de fidélité à son credo esthétique, plus que vaincu par la bienséance ou la confusion de l’agonie, le narrateur a préféré mettre l’accent sur l’interpénétration entre Venise et la mère. La lumière de l’ange asexué, craignant le corps féminin impose une condensation éblouissante. Ce choix prévaut aussi dans la dactylographie finale, de sorte que le séjour à Venise peut être lu comme l’apothéose des épisodes de la madeleine et du pavé de la cour de Guermantes.
Deux mouvements se disputent cette conclusion serrée de l’œuvre : la résurgence du scabreux et l’éclosion de la spiritualité. La complexité souvent obscène des caractères – Swann et Odette, Albertine et Charlus – démontrent le détournement du Bildungsroman esthétisant vers une exploration des drames de la sexualité sous-jacents aux masques sociaux. Toutefois, le mouvement inverse se manifeste avec force, notamment au regard de la suppression des pistes scabreuses dans la version courte d’Albertine disparue, et surtout par l’intégration narrative du thème spirituel au thème sensuel, qui inclut l’amour pour la mère dans la célébration de Venise. La tonalité de la fin du roman (déjà programmée dans les derniers cahiers du Contre Sainte-Beuve, mais aussi réaffirmée par le dernier remaniement d’Albertine disparue) impose la tendance sublimatoire. Venise paraît bien être le joint délicat entre les deux courants.
Faisant partie d’une refonte totale des derniers volumes du roman, la condensation dactylographiée obéissait sans doute à un souci publicitaire sinon commercial : la correspondance de Proust le montre sensible à de telles considérations. Elles n’empêchent pas que l’écrivain ait tenu de surcroît à mettre en valeur une quête initiatique, un trajet vers l’Orient sensuel et symbolique. Car telle est sa Venise, qui se fait maternelle pour mieux révéler l’incarnation qu’elle figure. Proust mourant n’écrit-il pas un « billet tremblé » à Céleste : « Barrez tout (sauf ce que nous avons laissé dans Albertine disparue) jusqu’à mon arrivée avec ma mère à Venise ».
Si un « coup de théâtre » situe la disparition définitive d’Albertine « au bord de la Vivonne », les coupures doivent logiquement concerner Albertine, ainsi que ses rappels et métamorphoses, tels les désirs du narrateur pour les petites Vénitiennes, pour deux jeunes filles venues d’Autriche, pour Mme Putbus. De même, Proust coupe les passages relatifs à la grand-mère, qui suggèrent le remords et rappellent le deuil d’Albertine. Il supprime la saga familiale des Guermantes et leurs mariages qui sont sans rapport avec Venise. Il impose quelques « essorages » du rythme narratif. Le souci de centrer le chapitre sur Venise-moi-maman, dans le registre d’un éblouissement, peut avoir dicté tous ces raccourcis.
La dernière dactylographie se tient ainsi dans la pureté d’un psaume surveillé. Elle met en évidence une « pierre angulaire » de l’esthétique proustienne. Venise est cette pierre angulaire : le caractère même du temps incorporé. A travers elle, le lien est désormais cristallisé entre le roman d’apprentissage érotique qui précède et les dernières pages contemplatives de la Recherche.
III. 3. La grâce du récit épuré
L’imaginaire proustien a le privilège de rendre évidents, en les exagérant, les traits constituants de tout imaginaire, tout particulièrement lorsqu’il échappe à la distinction ontologique/ontique. Si le narrateur se laisse fasciner par l’incarnation chrétienne, c’est que cette dernière, avant de devenir le moteur sans précédent d’une expansion artistique, tressa elle-même – dans la figure de la passion – l’indissociable co-appartenance du sens et du senti, du Verbe et de la chair. L’intermédiaire entre les deux – un état de grâce – devient un lieu possible. C’est l’espace-temps de la foi comme expérience imaginaire et, inversement, c’est l’expérience de l’imaginaire comme réalité impérative (comme foi) et cependant constructible (foi relativisée, dérisoire). Ni dans le status corruptionis du péché sans entendement, ni dans le status integrationis de l’entente conceptuelle pacifiée, le narrateur imaginaire se maintient dans l’entre-deux du status graciae.
Grâce qui brille et se réjouit comme le charme de la beauté, du bonheur ou de la salutation inclus dans le mot grec charis (χάρις). Grâce de l’élection, du pardon des péchés et de la plénitude de vie qui, don du dieu biblique, déborde sur son peuple, selon le mot hébraïque chén, cette autre façon de désigner YHVH. Grâce enfin de la personne de Jésus, qui annonce la « bonne nouvelle » dans la totalité joyeuse de l’Eglise primitive. Une « nouvelle » qui est une « personne », réconciliation de l’homme et de la parole, pleinement « suffisante » ou, au contraire, exigeant « mérite », selon les différentes étapes dans l’histoire de la théologie. De ses connotations païennes à sa personnalisation évangélique et ses disputatio doctrinales, la grâce se donne à l’entendement contemporain comme un récit salutaire de la passion humaine. Contagieux, libérateur, attirant : charisme et alliance, intensité de la régénération. Grâce violente, s’il en est. Violence de la passion dont l’ironie est la cicatrice, chez le narrateur de la Recherche. Grâce de l’homme sur la croix, et de ce pauvre duc de Guermantes, tel un vieil archevêque juché sur des échasses. Grâce de cette triste Albertine, qui fut objet de désir parce qu’elle est alter-ego abject de l’auteur, qui doit l’abandonner, qui doit s’abandonner, pour se transmuer en personnage imaginaire d’une expérience sublimatoire. Albertine doit disparaître pour ne laisser qu’un éclat, forcément bref, de Venise : de la Venise chrétienne, bien sûr ; mais qui tend à basculer dans la lumière d’un éblouissement, à la recherche de l’éblouissement innommable, biblique. Elle aussi, un caractère. Du narrateur.
Proust, tel que nous le livre le récit épuré d’Albertine disparue, n’est pas un moraliste qui aurait transformé la « vérité » en « justice ». Son expérience – Erlebnis – est celle de l’artiste qui réhabilite la justesse du récit dans un recueillement extrême. La civilisation n’a plus de fondation ? Ni les « dalles » des Guermantes, ni le « seuil » du baptistère ? Mais si, il nous reste la grâce de la condensation narrative, de la certitude imaginaire. C’est l’éclair du dire qui suspend le temps dans l’éternité.
Julia Kristeva
Conférence présentée dans le cadre de la journée d’étude organisée par Francis Marmande et Sylvie Patron, le 27 janvier 2007, pour les étudiants et les enseignants de khâgne moderne
A la recherche du temps perdu (Résumé)
Citation du jour
Marcel Proust
Citation du jour
Marcel Proust
Bernard Brun, Marcel Proust, Le Cavalier Bleu, novembre 2007
" Œuvre fleuve interminable, phrases trop longues… on parle beaucoup de Proust sans l’avoir lu, confondant souvent son roman et sa vie privée,en raison d’une ambiguïté qu’il avait voulue, mais qui laisse place à nombre d’idées reçues difficiles à démêler."
Marcel Proust et la religion- Bernard Brun
Marcel Proust et la religion - Bernard Brun.
Marcel Proust (1871-1922) est un enfant de la Troisième République, élevé dans la laïcité. Mais existe-t-il une littérature laïque, dont il serait un des plus illustres représentants ? Ses réactions à l’affaire Dreyfus et à la séparation de l’Église et de l’État semblent révéler quelques contradictions internes. Il avait suivi toutes les audiences du procès Zola et fait signer une pétition révisionniste. En revanche, une série d’articles réunis en 1919 dans Pastiches et Mélanges sous le titre « En mémoire des églises assassinées » révèlent une opinion opposée, qu’on ne saurait expliquer par l’esthétisme fin de siècle. L’article paru dans Le Figaro du 16 août 1904, « La Mort des cathédrales », attaque la loi de séparation au nom de la religion de la Beauté, bien sûr, mais pas seulement. Les églises désaffectées perdent leur fonction et se reconnaît vite la problématique de Ruskin, cette relation conflictuelle entre la modernité industrielle et l’architecture. Après l’architecte Eugène Viollet-le-Duc, Proust prend pour maître à penser John Ruskin le visionnaire social avant Émile Mâle, le véritable professeur d’esthétique. Il serait passé à la postérité comme le traducteur du prophète anglais, est-il nécessaire de le rappeler, et comme historien d’art, s’il n’avait écrit À la recherche du temps perdu.
JUIF OU CHRÉTIEN
Les motivations paraissent cependant ambiguës et cet article change de toute façon complètement de sens par sa republication après la guerre, sans que le texte en soit vraiment modifié. Les destructions du grand conflit remplacent un débat de politique intérieure, sur la laïcité. C’est le statut d’un écrivain agnostique dans une société laïque qui se pose maintenant. Les origines familiales n’expliquent pas tout. Un mariage mixte est à l’origine de la fortune des Proust. La famille maternelle appartient à cette grande bourgeoisie juive parfaitement assimilée, que l’affaire Dreyfus n’inquiète pas outre mesure. Les milieux de la haute finance ne bougeront pas. Le père monte à Paris, et le petit beauceron devient un illustre médecin hygiéniste. Il apporte une caution scientifique aux grands travaux du baron Haussmann. Le fils adoptera le contre-pied des théories paternelles sur l’urbanisme et l’hygiène. Il sera baptisé, élevé dans la religion catholique et fréquentera les écoles de la république. Tout ce qu’il a écrit révèle une excellente connaissance du rituel et des textes sacrés, pour les deux religions. L’influence maternelle aura été prépondérante. Une tension entre les deux familles est perceptible dans la correspondance et jusque dans le roman, mais le village français cède vite la place à la grand ville cosmopolite. L’asthme empêche le petit Marcel de fréquenter Illiers dès l’âge de neuf ans. Les souvenirs d’enfance n’en seront que plus prégnants.
L’enfant fragile et faible développe au lycée Condorcet des penchants homosexuels. Loin de l’hagiographie propre aux témoignages tardifs et aux biographies compassées, il est nécessaire de réfuter les lieux communs de l’identité juive comme toute tentative de récupération chrétienne. Écrivain agnostique, même pas athée, et dont la perversité était contenue seulement par la discrétion nécessaire à une époque où l’homosexualité était un délit, et pas l’antisémitisme, Proust a vite établi une relation douloureuse entre le judaïsme et son vice vécu comme une profanation de la mère adorée. C’est une clé de son oeuvre. Celle-ci cependant révèle plutôt un écrivain sociologue, qui campe, face à une société hostile, des caractères de juifs plus ou moins assimilés et confrontés à la réussite sociale, à l’affaire Dreyfus ou aux diverses formes de l’antisémitisme. Albert Bloch est l’écrivain israélite assimilé et honteux de ses origines. Charles Swann est le prince des élégances mondaines, juif et dreyfusiste. Le narrateur n’est ni juif ni homosexuel. Le roman n’est pas autobiographique et n’est pas censé décrire la réalité. En revanche, peu de portraits véritablement chrétiens. Un mauvais prêtre dans la maison pour homosexuels du Temps retrouvé, un prêtre voyeur à l’occasion de la mort de la grand-mère, l’univers de Combray qui est celui des vacances de Pâques, dans l’enfance, d’un rituel suranné et immuable. La religion chrétienne est attachée à la France profonde et à la routine superstitieuse de tante Léonie. Pas d’angoisse métaphysique dans ce roman, et la religion de la Beauté est une métaphysique sans transcendance, on y reviendra en son temps. La pâque juive prend le pas, d’une manière sournoise, par des allusions au meurtre rituel. Mais face au judaïsme se dresse le personnage emblématique du baron de Charlus, roi de la mondanité comme Swann en était le prince. Il ne s’attaque d’ailleurs jamais à celui-ci, liés qu’ils sont par une vielle amitié de collège. Grand seigneur catholique, dévot et homosexuel, il est un des derniers représentants d’une judéophobie religieuse et archaïque, à la différence de l’antisémitisme financier et social plus moderne. Et si c’est à Bloch qu’il réserve ses attaques les plus virulentes, d’un antisémitisme insoutenable pour l’époque contemporaine qui en a pourtant connu d’autres, c’est par dépit amoureux. Charlus aime un petit juif qui ne se rend compte de rien. Il est bien sur ce point un double du héros.
Elle est loin déjà la question de savoir quelle est la religion de Marcel Proust. L’écrivain prend bien soin de se distinguer de son narrateur et de ses personnages, même si son investissement personnel est très facile à discerner dans son écriture. À ce niveau, la transposition chrétienne est constante dans son oeuvre et, chaque fois qu’elle se produit, profanation, blasphème et sacrilège sont au rendez-vous. L’épisode fameux des aubépines par exemple, apparaît comme une contemplation esthétique, un effort pour dépasser le réel par l’excès de la description de simples fleurs des champs. Elles sont associées au mois de Marie et à la décoration de la vielle église de village. Mais elles le sont aussi et surtout au goût de la frangipane et à la rousseur, à la gourmandise et à un désir enfantin de jeunes filles (Mlle Vinteuil et Gilberte). Épines blanches et épines roses s’opposent, comme l’innocence au vice. Anodin ? Ce n’était pas l’avis de Robert de Montesquiou, un arbitre des élégances et du bon goût, qui désignait sans ambages ce morceau de bravoure de la littérature contemporaine comme « un mélange de litanies et de foutre »(1).
La description du porche de l’église campagnarde de Saint-André-des-Champs, symbole de la simplicité française, est liée au vice elle aussi(2). Théodore, le commis de l’épicier Camus, ressemble à une statue médiévale, mais cache des penchants vicieux que le narrateur découvrira beaucoup plus tard. C’est celui-ci qui fait figure de naïf, en confrontant la nature à l’œuvre d’art :
Devant nous, dans le lointain, Roussainville, dans les murs duquel je n’ai jamais pénétré, […] continuait à être châtié comme un village de la Bible par toutes les lances de l’orage qui flagellaient obliquement les demeures de ses habitants, ou bien était déjà pardonné par Dieu le Père qui faisait descendre sur lui, inégalement longues, comme les rayons d’un ostensoir d’autel, les tiges d’or effrangées de son soleil reparu.
Dans les cahiers de brouillon, cet ostensoir inattendu faisait son apparition dans la description des fenêtres du grand-hôtel de Balbec, la plage des vacances de l’adolescence, après Combray et Paris, comme soleil-ostensoir dans l’encadrement d’une fenêtre(3). Le Cahier 64, esquisse ce lien entre les « lueurs roses » du soleil couchant, la « chapelle », le « rideau rouge » du « Saint des Saints », le « tabernacle du ciel et de la mer » qui abrite cet ostensoir(4). Simple usage profane ? Il faut de toute façon se placer à l’intérieur du système de pensée catholique pour commettre un sacrilège. Mais quelle est la faute de Théodore, l’enfant de choeur de Combray ? Gilberte racontera bien plus tard au narrateur qu’il initiait les petites filles du village dans le donjon de Roussainville(5).
Les fils sont ténus mais ils tissent une toile qui n’est pas angélique. Il serait difficile dans ces conditions de tenter une récupération chrétienne. Quelques biographes ont essayé en présentant à la barre des témoins l’abbé Arthur Mugnier, la gouvernante Céleste Albaret, André Gide et François Mauriac jeunes visiteurs de Marcel Proust. L’aumonier des gens du monde, qui avait converti Huysmans, fréquentait l’écrivain au Ritz et à son dernier domicile de la rue Hamelin, aux dires de Céleste. La correspondance nous apprend que celui-ci lui avait envoyé la prépublication, dans Le Figaro, des « Épines blanches, épines roses » et qu’il déclarait au prêtre mondain : « Je voudrais que vous fissiez la connaissance de mon esprit »(6). Voulait-il aller plus avant ? Rien ne permet de l’affirmer, ni les déclarations de la gouvernante ni celle des deux jeunes écrivains visitant leur illustre aîné. Tous deux l’ont rencontré et ont échangé quelques lettres. Avec Gide, protestant et pédéraste, le malentendu est complet. En 1921 Gide félicite le romancier de son attaque contre « l’uranisme » (l’homosexualité), souligne la transposition sexuelle (les personnages féminins sont des hommes) et affirme que les « pédérastes » (il désigne par ce mot les pédophiles) ne sauraient aimer son oeuvre7. L’hypocrisie était au rendez-vous. Avec François Mauriac, rencontré dès 1918, Proust a pu partager l’expérience d’un milieu familial étouffant. Le reste appartient à l’interprétation des témoignages. S’il avait un sentiment religieux, il ne l’a pas exprimé clairement.
Que reste-t-il des évidences matérielles ? Si l’authenticité des anecdotes dénonçant un goût pour les combats de rats n’est pas établie, il reste un rêve qui compense une compulsion de tuer les parents :
En attendant nous les tenons dans une petite cage à rats, où ils sont plus petits que des souris blanches et, couverts de gros boutons rouges, plantés chacun d’une plume, nous tiennent des discours cicéroniens(8).
Il reste les petits secrétaires, la maison pour homosexuels de la rue de l’Arcade, tout une sexualité qui ne pouvait pas être vécue de manière aussi sereine qu’aujourd’hui et dans laquelle la culpabilité filiale tenait une large place. Mais la profanation de la mère ne saurait être placée sur le même plan que cette récupération, dans la littérature, d’une religiosité incertaine. La pédophilie n’est pas prouvée. L’enquête biographique et littéraire donne de maigres résultats. Le texte du roman ne renvoie qu’à lui-même, et jamais à un ailleurs qui se rapprocherait d’une opinion personnelle.
LA RELIGION DE LA BEAUTÉ
Mais cette religion de la Beauté, comme on disait à la fin du siècle précédent, ne représente-t-elle pas un effort vers une transcendance qui serait proche du sentiment religieux ? Un retour à Huysmans s’impose. Symbolisme et décadentisme, ces mouvements littéraires dont la signification échappe aujourd’hui représentent d’abord une crise de la représentation. La fonction de l’artiste est d’atteindre la « vraie réalité ». Marcel Proust voulait intituler « L’Adoration perpétuelle » la dernière partie de son roman, l’exposé esthétique du Temps retrouvé qui prend la forme d’une révélation. Évidemment, bien plutôt que l’adoration du saint sacrement l’analogie se fait avec l’Enchantement du Vendredi saint au troisième acte de Parsifal. Elle est suggérée par l’auteur lui-même dans sa correspondance, à propos de Tannhäuser : « C’est déjà la doctrine chrétienne qui sera littéralement exposée dans Parsifal »9. L’ambivalence proustienne se trahit à nouveau dans cette analogie. Le mysticisme wagnérien n’a pas grand-chose à voir avec la religion, c’est le détournement d’une mythologie européenne (la légende du Graal), et Proust achève de le vider de son contenu.
La réalité que l’écrivain cherche à atteindre dans un livre, par le style, consiste dans le rapport entre le sujet et le monde extérieur, grâce à la sensation. Le souvenir des sensations passées, ou plus précisément la coïncidence entre une sensation présente et une sensation passée, permet de saisir un moment hors du temps, le temps à l’état pur. Le fondement de cette esthétique semble reposer sur cette discontinuité temporelle qui déstabilise le sujet. La mémoire involontaire interroge le passé pour récupérer une identité perdue. Les sensations les plus obscures tiennent la place la plus importante dans cette reconstitution de la personnalité. La saveur d’une petite madeleine trempée dans du thé reconstitue le village de l’enfance tout entier, au début du roman, comme à la fin un faux pas sur le pavé parisien évoque la fraîcheur et l’obscurité du baptistère de Venise dont le dallage est disjoint, par contraste avec la chaleur et la lumière aveuglante du grand canal. Le bonheur causé par ces moments privilégiés suffit à justifier l’existence.
Le reste du roman est rempli de vérités moins importantes (les lois psychologiques ou sociales) et d’impressions obscures, d’expériences artistiques de second ordre. Encore une fois, il est nécessaire de dénoncer le démon de l’analogie qui semblerait justifier cette religion de la Beauté comme ces « épiphanies » qui servent à désigner les réminiscences, depuis que la critique proustienne a découvert James Joyce. Un nouvel exemple, tiré cette fois du Côté de Guermantes, permettra de souligner ce tissage d’impressions esthétiques et érotiques, sur une trame qui serait faite d’une longue métaphore religieuse au service d’un bonheur d’art. Proust était un charmeur et son écriture est charmante. Le héros accompagne Robert de Saint-Loup dans un petit village de banlieue, près de Versailles, pour aller chercher la maîtresse du jeune aristocrate, l’actrice Rachel en qui son ami reconnaît immédiatement une prostituée qu’il aurait pu connaître, « Rachel quand du Seigneur ». Il se détourne et se perd dans la contemplation des arbres fruitiers en fleur(10). Car c’est le temps pascal, comme dans le premier volume, même si, dans ces pages, le « mystère » évoqué est celui de la personnalité double de l’artiste, le « tabernacle » celui de son corps et le « Seigneur » la vulgarité blasphématoire de son nom de guerre(11). Le roman est fait de ces allusions subreptices et de continuels sous-entendus. C’est en effet à Combray que font référence la promenade qui longe « de petits jardins », la « barrière blanche », et cette « ravissante tapisserie provinciale » qui mêle cerisiers blancs et lilas mauves, robes blanches et toilettes mauves, les jeunes filles aux fenêtres et le grand poirier blanc qui
agitait en souriant et opposait au soleil, comme un rideau de lumière matérialisée et palpable, ses fleurs convulsées par la brise, mais lissées et glacées d’argent par les rayons.
Cette « terre grasse, humide et campagnarde eût pu être au bord de la Vivonne », la petite rivière qui traversait Combray. Ce paysage n’est pas plus innocent que celui de l’enfance, il est simplement chargé d’un symbolisme plus lourd. La beauté poétique des vergers disparaît après cette révélation de la nature véritable de Rachel. Dans la seconde partie de l’épisode, l’appel de l’art n’est qu’un masque destiné à cacher l’émotion du héros. Celui-ci se trompait en prenant les arbustes “ pour des dieux étrangers comme Madeleine s’était trompée
quand, dans un autre jardin, un jour dont l’anniversaire allait bientôt venir, elle vit une forme humaine et crut que c’était le jardinier.
Ces arbustes sont donc des « anges », et le poirier blanc fait sa réapparition. Il a changé de fonction, de pare-soleil il devient ange gardien :
Mais à côté des [maisons] les plus misérables, de celles qui avaient l’air d’être brûlées par une pluie de salpêtre, un mystérieux voyageur, arrêté pour un jour dans la cité maudite, un ange resplendissant se tenait debout étendant largement sur elle l’éblouissante protection de ses ailes de lumière en fleurs : c’était un poirier.
Rachel est Marie-Madeleine, le narrateur retrouvera finalement Robert du côté de Sodome comme il constatera que la femme qu’il a aimée était du côté de Gomorrhe.
La référence religieuse, la citation des Écritures jouent le même rôle que la description poétique et le beau style. Elles soulignent la faillite de l’amitié et de l’amour. Comme à Combray, elles cachent une démonstration esthétique et dégagent un charme profane. Mais quel charme ! Il fait oublier les déceptions de la vie et de l’art, art et vie qui ne prendront leur sens que dans les révélations du Temps retrouvé. En attendant, les résultats de l’enquête donnent une image négative de la religion de Proust. L’utilisation profane ou obscène de la religion semble toutefois cacher autre chose, comme si l’écrivain voulait brouiller les pistes. Le roman peut être lu avec plaisir par un lecteur antisémite comme par un libre-penseur. De toute façon, l’auteur ne s’identifie jamais explicitement aux idées exprimées dans son oeuvre. Quand bien même il le ferait, le baron de Charlus lui rappellerait immédiatement que le sacrilège et la profanation supposent la foi :
C’est du reste par là que demeurait un étrange juif qui avait fait bouillir des hosties, après quoi je pense qu’on le fit bouillir lui-même, ce qui est plus étrange encore puisque cela a l’air de signifier que le corps d’un juif peut valoir autant que le corps du bon Dieu(12).
Propos insupportables cependant sous la plume d’un écrivain qui pouvait revendiquer la double culture. L’ironie et la distanciation du narrateur ne suffisent pas à justifier un discours qui reprend les stéréotypes les plus dangereux de cette époque qui n’était pas belle : le juif Dreyfus n’a pas pu trahir puisque la France n’est pas son pays(13), ou encore : l’antisémitisme de Mme Sazerat est le meilleur garant de la sincérité de son révisionnisme(14).
MORT ET RÉSURRECTION
Cette duplicité d’un roman qui veut être le Livre où convergent tous les discours possibles s’étendra-t-elle au romancier ? Lui qui refusait de voir en son oeuvre un miroir de lui-même a écrit ses plus belles pages sur le sommeil et sur le rêve, sur la mort et sur ce qu’il appelait la « survie ». Ces textes montrent-ils une plus grande authenticité ? La maladie et la mort de la grand-mère mêlent à un effort de réalisme et à une critique de la médecine une symbolique mythologique et médiévale qui affaiblissent la portée de ce morceau célèbre(15). Il est écrit pour être lu avec la résurrection que représente le chapitre des intermittences du coeur dans Sodome et Gomorrhe (16). En se déchaussant dans sa chambre du Grand-Hôtel, lors de son second séjour à Balbec, le héros se souvient de sa grand-mère faisant le même geste lors du premier séjour dans la station balnéaire. Ce bel exemple de souvenir involontaire est lié à l’angoisse du cauchemar qui le suit immédiatement, il ne donne pas le bonheur que donne habituellement la réminiscence, car il est lié à la mort. Il restitue « la réalité vivante », mais il souligne en même temps la discontinuité du moi : « Notre âme totale n’a qu’une valeur presque fictive ». Cette discontinuité de la conscience pose un problème qui revient régulièrement tout au long du roman :
C’est sans doute l’existence de notre corps, semblable pour nous à un vase où notre spiritualité serait enclose, qui nous induit à supposer que tous nos biens intérieurs, nos joies passées, toutes nos douleurs sont perpétuellement en notre possession.
Comment établir un lien entre sensation du corps, mémoire du passé et conscience de soi ? La question de la transcendance est posée tout particulièrement à l’occasion de la mort de l’écrivain Bergotte(17) et de celle du musicien Vinteuil(18). Elle s’inscrit cependant dans le cadre plus général d’une réflexion du narrateur sur sa propre vocation littéraire, et surtout à partir d’une discussion fictive de Proust avec son cousin Henri Bergson, pour son ouvrage L’Énergie spirituelle, paru en 1919. Le Côté de Guermantes (19) se fait l’écho de cette réflexion sur le sommeil et sur le rêve, sur la conscience, la mort et la résurrection, réflexion développée d’abord dans le cahier de brouillon n° 59 et dont Sodome et Gomorrhe profitera ensuite(20). Contre Bergson Proust rappelle que la mémoire est altérée par les narcotiques et par le sommeil profond. La question n’est pas en effet seulement celle de la possibilité du souvenir dans le réveil et dans le rêve, grâce à la sensation physique, mais celle de l’identité : « On n’est plus personne » en se réveillant d’un sommeil de plomb. Ce sommeil est comme une mort, et « la résurrection au réveil » est comme un souvenir arraché à l’oubli. Les trois pages du Côté de Guermantes se terminent par cette conclusion problématique : « Et peut-être la résurrection de l’âme après la mort est-elle concevable comme un phénomène de mémoire ». En admettant qu’il s’agisse bien d’une réflexion personnelle, il faut noter l’erreur théologique sur la résurrection des corps, l’âme étant un principe immortel, ainsi qu’un glissement analogique. La mémoire garantit la continuité de la conscience et le sujet la projette sur l’avenir pour apaiser son angoisse. C’est un simple problème de logique analytique, doublé d’une espérance.
Cette réflexion prend sa source dans le Cahier 59, où elle est beaucoup plus développée. Dans l’ordre sont examinés : le réveil après un sommeil profond (quand le valet de chambre vient réveiller son maître), le sommeil et l’état de veille (deux temps et deux vies différents), le rôle des sensations physiques dans la formation des rêves, celui des narcotiques sur la mémoire, une première réponse à Bergson (la destruction du cerveau empêche la survie) et une seconde sur la faculté du souvenir. Deux additions reprennent les deux vies différentes et le réveil par le valet.
Le Côté de Guermantes a sans doute profité, lors de la recomposition des épreuves chez Gallimard, de ces notes de lecture tardives, mais c’est surtout dans les cinq pages de Sodome et Gomorrhe qu’elles trouvent leur prolongement.. Le rêve est la résurrection du passé, affirmait Bergson dans « Le Rêve ». Il ajoutait dans « L’Âme et le Corps » : « La vie mentale est plus étendue que la vie cérébrale » et peut donc passer sans problème des intermittences du moi à l’immortalité de l’âme. Proust reconnaît cette fonction du rêve et ces intermittences, mais pour la survie sa critique se fait plus précise et plus sévère. La dissolution du souvenir entraîne celle de la conscience :
Malgré tout ce qu’on peut dire de la survie après la destruction du cerveau, je remarque qu’à chaque altération du cerveau correspond un fragment de mort(21).
Nous possédons tous nos souvenirs, sinon la faculté de nous les rappeler, affirmait Bergson. « Mais qu’est-ce qu’un souvenir qu’on ne se rappelle pas ? » rétorque Proust qui conclut :
Mais alors que signifie cette immortalité de l’âme dont le philosophe norvégien affirmait la réalité ? L’être que je serai après la mort n’a pas plus de raison de se souvenir de l’homme que je suis depuis ma naissance que ce dernier ne se souvient de ce que j’ai été avant elle.
Le philosophe norvégien est un disciple de Bergson qui a réellement existé, détail moins important bien sûr que la ligne générale : si tout est dans la conscience, celle-ci disparaît avec le corps. C’est donc ailleurs encore qu’il faut chercher une raison d’espérer. Cette méditation sur la mort est tardive, à partir de Bergson et après la Grande Guerre qui a sans doute infléchi et approfondi le sentiment de Marcel Proust. Le ton devient plus grave quand sont évoquées dans le roman la mort de l’écrivain et celle du musicien. Le culte de la Beauté a plusieurs ministres, selon une hiérarchie qui donne curieusement la préséance au second sur le premier. Et pourtant la mort de Bergotte est mise en scène d’abord, avec la plus grande intensité dramatique :
On l’enterra, mais toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, ses livres, disposés trois par trois, veillaient comme des anges aux ailes éployées et semblaient pour celui qui n’était plus, le symbole de sa résurrection(22).
Cette fois, l’imagerie catholique conclut une réflexion argumentée dont le fondement est esthétique : l’« artiste athée » n’a aucune raison de travailler pour une œuvre qui passera à la postérité, s’il n’a pas le sentiment de venir d’un « monde différent » auquel il est destiné à retourner. Si la mort du peintre Elstir ne connaît pas un traitement aussi élaboré, celle du musicien Vinteuil, moins de cent pages plus loin dans La Prisonnière, reprend l’interrogation essentielle :
Si l’art n’était vraiment qu’un prolongement de la vie, valait-il de lui rien sacrifier, n’était-il pas aussi irréel qu’elle-même ? À mieux écouter ce septuor, je ne le pouvais pas penser(23).
Brève allusion, répétition dubitative de la question posée au sujet de Bergotte, elle-même entourée de précautions oratoires mais pourtant centrale, entourée d’une rhétorique qui la prépare et qui la prolonge, et qui fait de ces vingt-cinq pages consacrées à l’audition de l’oeuvre posthume du musicien un superbe manifeste esthétique et peut-être religieux. Un chant mystique du coq, un appel de l’éternel matin, le motif triomphant des cloches, les autres mondes créés par l’artiste, sa réincarnation dans la musique, les différents levers de soleil intérieurs, la prière et l’espérance, les éternelles investigations que suscite la puissance de son effort créateur, le monde des anges et le chant éternel, voici autant d’allusions imprécises qui tissent une toile serrée autour de déclarations plus importantes, l’« accent unique qui est une preuve de l’existence irréductiblement individuelle de l’âme » et surtout la « patrie inconnue » qui renvoie au monde différent d’où venait Bergotte, à une joie ineffable qui semblait venir du Paradis, joie supraterrestre, à la communications des âmes et, de nouveau, à l’espérance mystique de l’ange écarlate du matin. Voilà un centon citationnel qui ne remplace pas un acte de foi. Il en tiendra lieu cependant, puisqu’il n’y a rien d’autre.
La mort de la grand-mère et de la mère (qui ne meurt pas dans le roman, puisqu’elle est un double de la grand-mère) est en dehors de ce questionnement. Elle représente un traumatisme familial. Inutile de parler de la mort allusive d’autres personnages importants du roman. La révélation esthétique assimilée à un appel de l’infini connaît trois étapes à la fin du roman. Le septuor posthume de Vinteuil est la première et peut-être la plus importante. La conversation de critique littéraire qui suit, engagée avec l’arrangement pour piano du septuor joué par Albertine, a une moindre importance. On retombe dans l’immanence et c’est la même immanence que l’on trouve dans la scène finale du Temps retrouvé. La reconstruction du sujet conscient par la mémoire involontaire permet au narrateur d’écrire enfin un livre qui sera celui qu’on vient de lire. C’est le même raisonnement circulaire qui permet d’assurer à l’artiste la pérennité de son oeuvre, tant qu’elle aura des lecteurs. Les deux dernières étapes sont paradoxalement très en retrait, par rapport à l’extase quasi mystique du septuor entendu et qui était au niveau du troisième acte de Parsifal. Métaphysique sans transcendance, pour ce qui n’est en définitive qu’un retour à soi-même. L’œuvre d’art garantit au sujet son identité retrouvée en même temps que son passage à la postérité, qui semble bien être la définition proustienne de l’éternité. La série romanesque que Marcel Proust a laissée est simplement la recherche de cette identité et de cette postérité.
Notes
1 Correspondance, éd. Philip Kolb, Plon, XI, 79.
2 CS, éd. “ bibliothèque de la Pléiade ”, Gallimard, I, 261-262.
3 Figure abandonnée dans le texte de À l’ombre des jeunes filles en fleurs parce qu’elle a été déplacée, précisément, dans l’épisode de la pluie sur Saint-André-des-Champs.
4 Cahier 64, f°38r°. Cité dans l’article de Mireille Naturel, “ L’image du soleil-ostensoir dans le Cahier 64 ”, Bulletin d’informations proustiennes n°26, 1995.
5 TR, IV, 269-271.
6 Corr., XVII, 113.
7 Corr., XX, 239 sqq.
8 CG, II, 386.
9 Corr., I, 386.
10 CG, II, 454-459.
11 Citation de La Juive de Fromental Halévy (1835).
12 SG, III, 492.
13 CG, II, 584.
14 CG , II, 586.
15 CG , II, 609 sqq .
16 SG , III, 152 sqq .
17 Pr ., III, 692-693.
18 Pr ., III, 759.
19 CG , II, 384-391.
20 SG , III, 370-375.
21 SG , III, 374.
22 Pr ., III, 692-693.
23 Pr ., III, 759.
Pour citer cette page
Bernard Brun, «Marcel Proust et la religion», [En ligne],
Mis en ligne le: 19 octobre 2006
Disponible sur: http://www.item.ens.fr/index.php?id=13957.
Notice bibliographique
Les Romanciers et le catholicisme, Les Cahiers du Roseau d’Or, N°1, Éditions de Paris, 2004, p. 63-81. (p. )